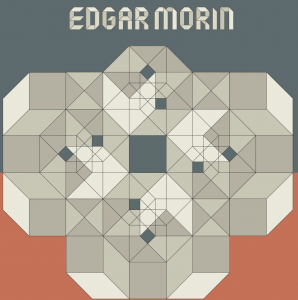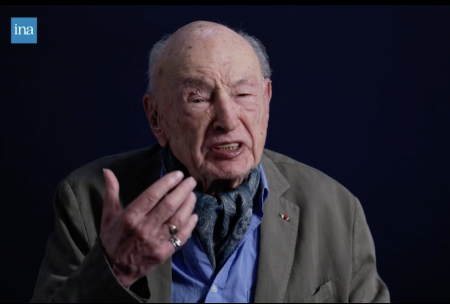- © DR
Biographie
Plus de cent ans pour devenir Edgar Morin*
Une vie faite de plusieurs vies, entretissée de drames et d’événements inouïs, de poésie inattendue et de rencontres décisives. Repères, balises et détails d’une trajectoire exceptionnelle.
8 juillet 1921 : Les prénoms des morts, la lutte pour la vie
Depuis toujours dans cette longue vie qui aura traversé le XXe siècle, les éléments contraires ou déchaînés accompagnent Edgar Morin, l’intellectuel comme le citoyen et l’être humain. Elle est son identité profonde. Fait peu connu, le combat de vie et de mort s’est incrustée dans le choix même de son prénom. Lors de sa naissance le 8 juillet 1921, au 10 rue Mayran, dans le 9e arrondissement de Paris, Edgar Nahoum était prédestiné à porter, comme un boulet, le double prénom de ses deux grands-pères morts, David et Salomon. Mais, effrayés par cette tradition morbide pour leur cher petit «Edgarico» qu’ils ont d’ailleurs crû mort-né durant sa première heure terrestre, les parents Vidal Nahoum et Luna née Beressi se repentent et le rebaptisent Edgar. Pour ces Juifs séfarades venus de Salonique, il s’agit là d’une volonté d’enracinement par un prénom francisé, mais aussi d’une référence explicite et admirée dans cette famille à une grande figure du socialisme républicain : Edgar Quinet (1803-1865). C’est donc un prénom très politique qui lui est finalement choisi – et qu’Edgar entérinera lui-même, bien plus tard, par acte notarié.
Juin 1930 : Luna, la mère-astre
De la mort et des obsèques de Luna, sa mère, rien, strictement rien ne fut dit à l’enfant unique. Vidal, son père, chercha à l’épargner en se réfugiant dans le silence. Il lui faudra attendre les années 1980 pour qu’Edgar puisse connaître les circonstances exactes de la disparition de sa mère, ainsi relatées dans ce long article publié le 2 juillet 1931 par L’Indépendant, un journal francophone de Salonique (Grèce).
« Paris, le 29 juin.
Un deuil des plus cruels vient de frapper les familles Nahum et Beressi, qui comptent parmi les plus notables de la colonie judéo-salonicienne de Paris ; Mme Luna Vidal D. Nahum, fille de feu Salomon Beressi et de Mme née Myriam Mosseri, a été enlevée à l’affection des siens, à l’âge heureux de trente et un ans [erreur du journal – NdA], avec une soudaineté déconcertante.
La malheureuse jeune femme qui habitait Rueil, une des plus jolies banlieues de la capitale, devait assister, vendredi dernier, 2 juin, à un déjeuner de famille. Au moment où le train s’ébranla, Mme Nahum laissa tomber sa tête contre le dossier de la place qu’elle occupait. Sa jeune sœur qui l’accompagnait et les voyageurs du compartiment crurent qu’elle venait d’être prise d’un étourdissement et essayèrent de la soulager. Mais en arrivant à la gare Saint-Lazare, les médecins constatèrent que la jeune femme avait succombé à une crise cardiaque… »
Edgar d’enfant unique devient orphelin. « Edgarico » est élevé par son père et sa tante Corinne Beressi, rue des Plâtrières dans le 20e arrondissement de Paris. Mais l’enfant met un point d’honneur à étudier à son cher lycée Rollin, au pied de la Butte Montmartre.
1936-1940 : Le lycée Rollin, la guerre d’Espagne et la filière « frontiste » du pacifisme
Dans les années 1930, l’adolescent parisien se nourrit de lectures intensives et de débats politiques, et ce, de façon passionnée. La crise économique et sociale, trente millions de chômeurs en Europe, le fascisme en Italie, Hitler au pouvoir… Les nuages d’orage s’accumulent. De ses années de maturation, il nous dit : « Il y avait en moi, un débat profond entre tendance des Lumières sceptique et rationaliste, et tendance romantique de communion et d’effusion. Et ce débat ne se résolvait pas, il ne devait jamais se résoudre… »
Sa matrice intellectuelle est son cher lycée Rollin (aujourd’hui Jacques-Decour), au pied de la butte Montmartre et à deux pas de Pigalle. Son état d’esprit ? Dans un petit carnet de notes de l’époque, cette phrase d’éternelle jeunesse : « Maintenant, l’inégalité est encore plus dégoûtante qu’auparavant. Autrefois, seule la naissance la faisait tandis qu’aujourd’hui, c’est l’argent.»
Edgar Nahoum fait partie de cette génération de lycéens qui, à gauche, ont été marqués par la guerre d’Espagne. La chute de Barcelone le fait pleurer, tout comme ses petits camarades. Dans cette tourmente d’avant-guerre, le surnommé « P’tit livre », car il se promène toujours avec des journaux et des ouvrages de toutes sortes sous le bras, se forge un esprit curieux de tout, ne pouvant se résoudre à puiser à une seule source. Son premier acte d’engagement est d’aller prêter main-forte au journal anarchiste de la Solidarité internationale antifasciste (SIA), périodique fondé en octobre 1938 par le pacifiste Louis Lecoin, et dont il était un fervent lecteur. Le lycéen aide à la confection de colis de solidarité qui étaient destinés aux valeureux anarchistes de la Catalogne. Mais c’est à un meeting organisé par les trotskistes en soutien au Parti ouvrier d’unification marxiste (Poum) qu’il vibre pour la première fois des discours de soutien, de la petite foule militante et des chants révolutionnaires, dont il dira qu’ils le mettent toujours dans « un état second ».
Le lycéen de Rollin multiplie ses foyers d’idées. Il est un sympathisant libertaire mais qui sait aussi apprécier la lecture d’Anatole France. Il lit L’Unique, organe des anarchistes dits individualistes, mais aussi L’Éveil des peuples du catholique utopiste Marc Sangnier, mais plus encore Essais et combats, une publication des étudiants socialistes tendance Marceau Pivert, proche des trotskistes. Il n’oublie pas de dévorer Le Canard enchaîné. Et surtout, il est très impressionné par La Flèche, le journal de Gaston Bergery (1892-1974), fer de lance du pacifisme. Gaston Bergery… Les détracteurs du député de Mantes-la-Jolie le surnommaient le « Radical-Bolchevik » parce qu’il fustigeait les excès du capitalisme, et son désordre. On pourrait l’arrimer dans sa version politique au mouvement nébuleux et mal connu des non-conformistes des années 1930, un mouvement de jeunes intellectuels à la recherche d’une nécessaire révolution, mais autre que le modèle soviétique à l’œuvre. Le non-conformisme a produit les conceptions du personnalisme et du fédéralisme européen, la revue Esprit, des figures comme Emmanuel Mounier, Denis de Rougemont, Jacques Ellul, Robert Aron, Thierry Maulnier mais aussi, pour d’autres, des allégeances au pétainisme et même, selon l’historien des idées Zeev Sternhell, des théories à la française pour « un fascisme sophistiqué ».
« La paix à tout prix » est le mot d’ordre des frontistes a-marxistes, qui réussissent à capter les « Jeunes Turcs » de la SFIO, communistes défroqués et étudiants des gauches comme Edgar Nahoum. Alors étudiant à la Sorbonne, il fréquente avec assiduité le cercle « frontiste » à l’hiver 1938- 1939. Tous les jeudis après-midi, au sous-sol du grand café Crillon, dans le quartier de l’Odéon, se tiennent les entretiens du Front commun contre le fascisme, contre la guerre et pour la justice sociale. La guerre va faire éclater ce mouvement, alors que Bergery dérive de plus en plus vers l’extrême droite.
Juin 1940 : L’étudiant Edgar Nahoum se réfugié à Toulouse.
1942 : Il passe sa licence d’histoire-géographie et de droit.
1942-1944 : De Nahoum à Morin
C’est encore la politique qui modifie et remanie de fond en comble l’identité du jeune Edgar Nahoum. À vingt et un ans, dans la Résistance, Edgar Nahoum se choisit le « blaze » de Manin, en référence à l’un des personnages d’André Malraux dans L’Espoir. Mais la camarade chargée de faire circuler son identité dans le réseau entend mal et l’appelle Morin. C’est à cette époque que Morin s’invente politiquement.
Dans l’exode à Toulouse, puis sous une occupation qui se durcit et des lois antisémites qui le menacent, l’étudiant juif et pacifiste est devenu Morin, chef de guerre communiste. Son engagement dans la Résistance se cristallise en 1942, à la faveur de Stalingrad. Mais c’est dans une cave « mondaine » qu’Edgar fait toute son éducation politique et le plein de contacts : il sympathise avec Clara Malraux (1897-1982), ex-épouse d’André, qui s’est réfugiée, avec sa jeune fille Florence, dans le sous-sol d’un pavillon, et reçoit comme à Paris intellectuels, artistes et opposants politiques. L’écrivain intrépide va peu à peu amener l’étudiant vers la Résistance. «Dans le domaine de la pensée comme dans tout autre, les zigzags de parcours se justifient mieux en temps de guerre qu’à tout autre moment, explique- t-elle dans ses Mémoires. Pour moi, j’acceptais le compagnonnage avec les communistes puisque nous menions – enfin – le même combat ; Edgar, lui, se battit parce qu’il croyait dans le marxisme, et quelque peu dans le communisme.»
Morin est communiste, car il a fait la découverte de Karl Marx et, surtout, a vécu « l’illumination hégélienne » qui lui « révèle que l’affrontement des contradictions était une nécessité de la pensée ». Politiquement et intellectuellement, il se décrit volontiers comme un « marxiste assimilateur » qui veut percevoir les différentes facettes de la réalité, y compris contradictoires. La mise en cycle des savoirs, et l’effort intellectuel de relier le disjoint relèvent bien du domaine morinien, comme une esquisse de sa Méthode à venir.
Communiste encarté certes, il est dans la Résistance comme un «sous-marin » du parti stalinien, qui prospère dans un réseau, qui, au fond, lui ressemble: le Mouvement de résistance des prisonniers de guerre et déportés (MRPDG), mené par Michel Cailliau, le neveu du général de Gaulle. Non seulement ce réseau est gaullo- communiste (il se lie d’amitié avec le gaulliste Philippe Dechartre) mais de plus franco-allemand, à l’image de l’adjoint de Morin, Gehrard dit « Jean » Kratzat, qui après les coups de la Milice française, puis de la Gestapo de Klaus Barbie, meurt sous les balles de l’armée allemande à Lyon. Après la fusion des réseaux, le lieutenant Morin finit la guerre aux côtés de François Mitterrand. S’il loue les qualités personnelles de ce dernier, il ne votera jamais pour lui, mais le défendra bec et ongles lors de la polémique sur son passé vichyste, surgie de la biographie de Pierre Péan, Une jeunesse française (1994).
1944 : Le résistant du Réseau Charette puis du MNPGD (Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés) est homologué lieutenant des Forces françaises combattantes.
1945-1965 : Dans la tourmente stalinienne
Après-guerre, le lieutenant Morin et sa compagne la future sociologue Violette Chapelleaubeau, connue à Toulouse dans la Résistance et qu’il a épousé en 1945 à la mairie du 18e arrondissement de Paris, se portent volontaires auprès de l’état-major de la Première armée française à Baden-Baden en Allemagne. Objectif : « dénazifier » les populations allemandes. Il commence parallèlement sa première étude sociologique sur les jeunes Allemands errant dans les décombres de l’après-guerre. Il rencontre également Martin Heidegger, auquel il remet une lettre de Max-Pol Fouchet. Puis, démobilisé de son poste de Chef du bureau « Propagande » à la direction de l’Information au Gouvernement militaire français en Allemagne, Morin s’ennuie. Il médite sérieusement un essai sur la connerie – qu’il réalisera à travers un petit roman intitulé Une cornerie, en 1947. Il est même, en 1949, l’un des premiers « chômeurs intellectuels » déclarés de l’après-guerre ! Il milite au Parti, écrit quelques articles et un livre de médiocre facture sur l’Allemagne. Ses amis de l’époque sont ceux de la Résistance : Marguerite Duras, Dionys Mascolo, Robert Antelme, tous communistes dissidents. Une commune amitié qui se soldera par leur éviction du Parti.
1947 : Naissance de sa fille Irène ( Future Irène Pennachioni-Léothaud, enseignante en sociologie des universités François-Rabelais de Tours et de l’Université fédérale de l’État du Ceara au Brésil, et essayiste).
1948 : Naissance de sa fille Véronique (Future Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue EHESS et essayiste).
1950 : Edgar Morin entre au CNRS, grâce au parrainage de Georges Friedmann (1902-1977), Vladimir Jankélévitch (1903-1985) et Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).
1951 : Edgar Morin publie son tout premier ouvrage anthropologique, L’Homme et la Mort aux éditions Corrêa (animé par le philosophe d’origine brésilienne, Robert Corrêa – 1901-1983). Le sociologue est exclu du Parti communiste pour avoir écrit un article dans France Observateur, de son ami le journaliste, mais aussi résistant et futur diplomate Gilles Martinet (1916-2006).
Dès 1949, Morin, qui avait choisi le communisme de guerre à ses yeux le plus apte à vaincre l’autre titan, le nazisme, prend ses distances avec le PCF, le parti le plus stalinien de toute l’Europe de l’Ouest. Pourtant, Maurice Thorez en personne avait apprécié son essai L’An zéro de l’Allemagne, paru en 1946, et l’avait même invité à collaborer aux influentes Lettres françaises. Il aurait pu aussi animer la page « Culture » de L’Humanité, mais le militant intellectuel décline la proposition car il se reconnaît bien plus dans le travail de spéculation d’un Elio Vittorini, écrivain communiste italien en rupture de ban. Morin finit par rentrer dans ce « petit far west de la Recherche » qu’est le CNRS en 1950. Il y entre par un trou de souris, grâce au sociologue Georges Friedmann et aux recommandations du philosophe Wladimir Jankélévitch, connus à Toulouse dans la Résistance.
Pour ainsi dire, la guerre froide refroidit ses ardeurs communistes. Le jdanovisme – inspiré du nom du militant communiste ukrainien Andreï Jdanov, désignant le contrôle idéologique de la pensée et des œuvres d’art imposé par le Parti – l’éreinte. De ce passage long et tortueux au PCF, que sanctionna une exclusion par un tribunal populaire de quartier en 1951, Morin concevra l’admirable Autocritique, en 1959. Il s’agit d’un témoignage de l’intérieur qui reste son grand classique politique. Il y autopsie les effets du stalinisme dans ses mécanismes d’aveuglement idéologique. Mais le récit de désintoxication pourrait être celui de n’importe quelle organisation psychorigide ou secte.
L’insurrection de Budapest en 1956 le marque profondément. Il aide son ami, l’historien d’origine hongroise François Fejtö (1909-2008), à rompre avec son pays. Il écrit désormais sur le cinéma et bientôt sur la guerre d’Algérie (il était pro-Messali Hadj et contre le FLN) chez les « traîtres » de jadis, ceux de France Observateur (futur Nouvel Observateur). Pour Morin, remarqué pour son travail anthropologique L’Homme et la Mort, publié en 1951, la «période chrysalidaire » du postcommunisme est bien engagée.
1956 : Publication de Le Cinéma ou l’Homme imaginaire. Essai d’anthropologie par les éditions de Minuit.
Il cofonde avec Jean Duvignaud (1921-2007), Roland Barthes (1915-1980) et Colette Audry (1906-1990), bientôt rejoint par Kostas Axelos (1924-2010) et bien d’autres, la revue Arguments et en sera le directeur jusqu’en 1962.
1957 : Publication de Les Stars par les Éditions du Seuil, collection « Le temps qui court ».
à suivre…
* Cette biographie a été rédigée par Emmanuel Lemieux pour la Fondation Edgar Morin.
© Emmanuel Lemieux et Fondation Edgar Morin, 2025.
Emmanuel Lemieux, journaliste, auteur et éditeur, a notamment écrit la biographe d’Edgar Morin, L’indiscipliné (Éditions du Seuil, 2009 / Points 2020), et l’enquête sur ses années de résistance et de formation, Le Réseau. Les derniers secrets de la résistance (Le Cerf, 2023).
Edgar Morin est docteur Honoris Causa
des universités : de Pérouse (Italie) / de Milan (Libera Universita de lingue e communicazione – Italie) / de Messine (Italie) / de Bergame (Italie) / de Palerme (Italie) / de Naples (Italie) / de Valence (Espagne) / de Barcelone (Espagne) / de Genève (Suisse) / de Bruxelles (Belgique) / d’Odense (Danemark) / de Thessalonique (Université Aristote – Grèce) / de Cracovie (Pologne) / de Natal (Brésil) / de Joa Pessoa (Brésil) / de Porto Alegre (Brésil) / de Rio de Janeiro (Université Candido Mendes – Brésil) / de Lima (Université Ricardo Palma – Pérou) / de Lima (Université nationale Majeur de San Marcos – Pérou) / de Lima (Université La Cantuta – Pérou) / de Huamachuco (Université nationale Pedro Ruiz Gallo – Pérou) / de Guadalajara (Mexique) / de Vera Cruz (Mexique) / de La Paz (Université technologique – Bolivie) / de Santiago (Chili) / de Laval à Québec (Canada)
du Conseil supérieur de l’éducation d’Andalousie (Espagne) et de l’Institut Piaget (Lisbonne, Portugal).
Pour aller plus loin
De 1996 à 2019, la SESSCP a invité Edgar Morin dans le cadre de ses formations permanentes à venir présenter ses réflexions et son œuvre à un large public. Toutes ces rencontres, et bien d’autres documents, sont mises à la disposition du public sur le site créé spécialement par la SESSCP [ici] afin de garder vivante et permanente la réflexion sur la mémoire, la culture, la latinité, les incertitudes et aspirations qui caractérisent l’humanité au XXIe siècle.
[en portugais (Brésil) et en français]
Au cours d’un long entretien (2 h 37) mené fin 2023 par Laure Adler, Edgar Morin revient sur sa vie et son parcours. Depuis son enfance et la mort de sa mère, jusqu’aux évènements politico-historiques qui l’ont mené à la pensée complexe, en passant par ses études, la Résistance, son rapport à la politique et à la guerre, mais aussi ses amitiés, ses amours, et son regard sur notre société et le monde actuel.
L’intégralité de l’entretien est visible sur le site d l’INA [ici].
Jean-Michel Djian a réalisé en 2022 un documentaire (53 min.) intitulé Edgar Morin, journal d’un épicurien et consacré à la vie et à l’œuvre d’Edgar Morin.